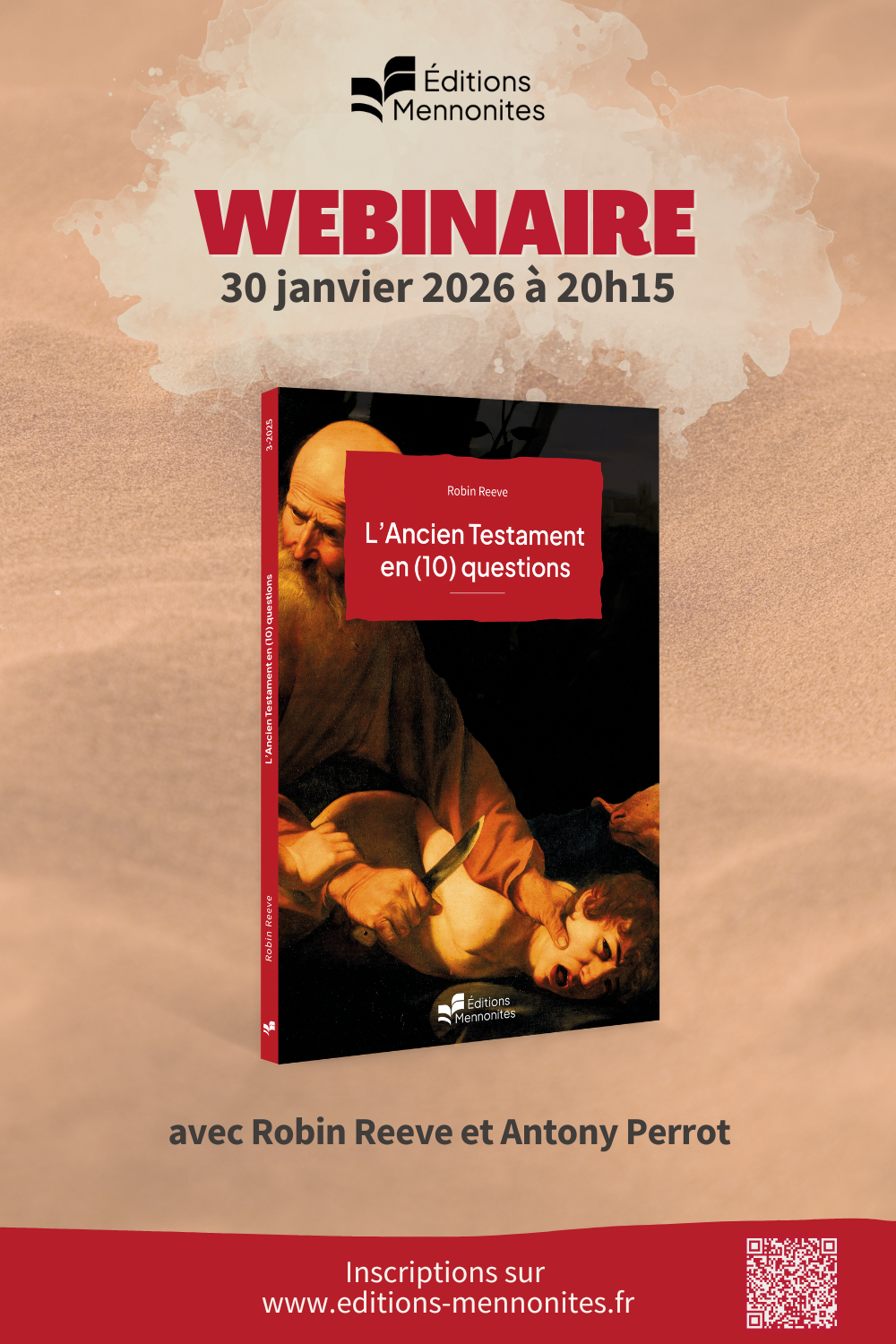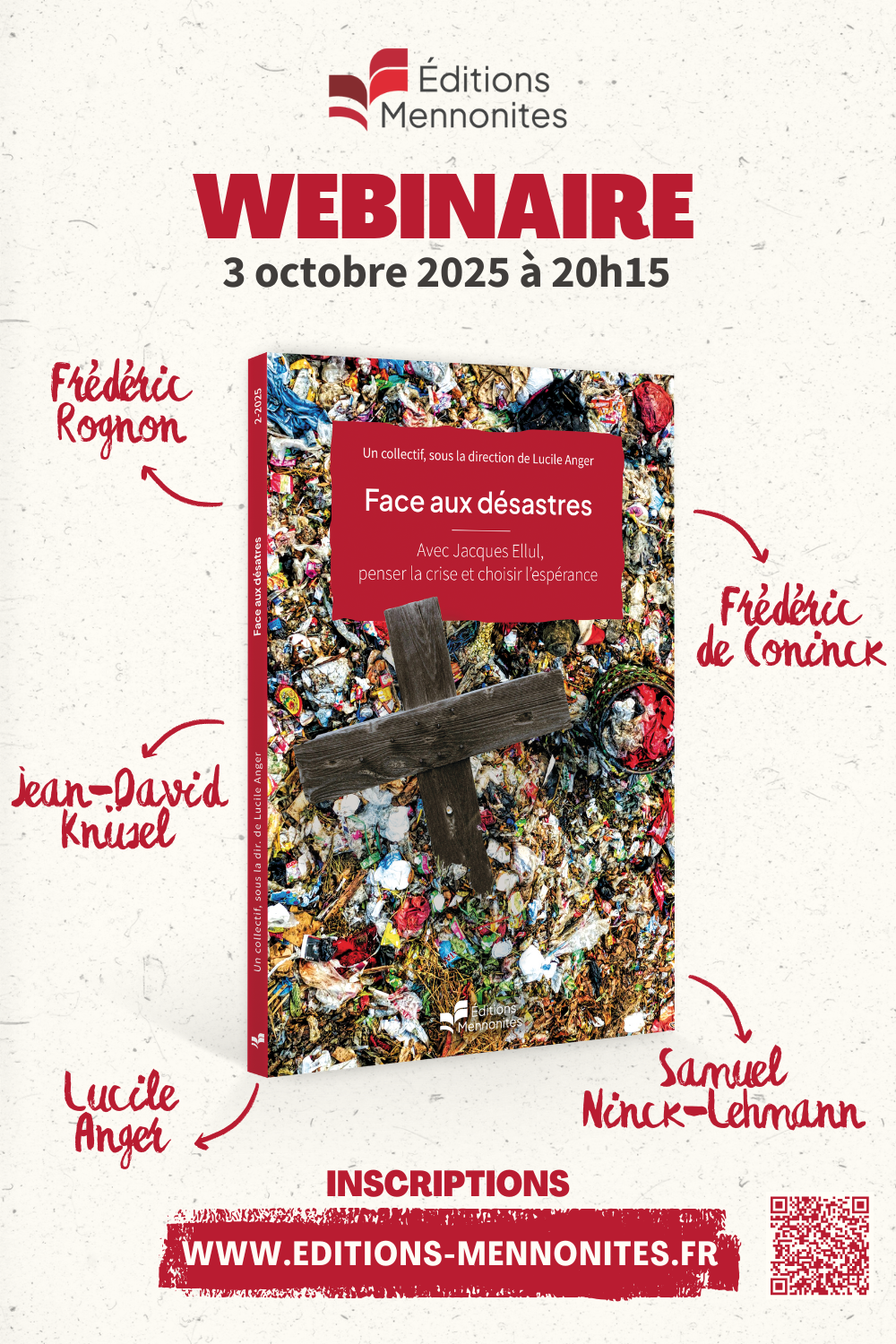Des pierres vivantes
Il y a presque 20 ans, je goûtai au programme EFraTA (Études Francophones de Théologie Anabaptiste) dans le cadre reposant et bienfaisant du Bienenberg. Dans ces années 2007 à 2011, je terminai ma formation théologique et commençai un ministère pastoral. Je me souviens bien de ces quatre rendez-vous annuels qui résonnaient au cœur de ma découverte du ministère pastoral et de cet objet si fascinant : l’Église, celle que Dieu appelle, conduit et nourrit depuis près de 2000 ans. Et puis cette Église locale dont j’étais pasteur était bien plus qu’un objet de travail : une famille, des amis, un lieu de rencontre des cultures et d’apprentissage de la foi ou encore, comme aimait à le dire un de mes professeurs, un laboratoire expérimental de la vie chrétienne !
La particularité de cette formation théologique dans une perspective anabaptiste résidait dans la place centrale accordée à l’Église. Nos affirmations sur Dieu n’étaient pas élaborées à partir de points de vue individuels, isolés, si caractéristiques d’une modernité qui fragmente, mais à partir de la vie de communautés chrétiennes, au travers de textes allant du xvie siècle (parfois même antérieurs) jusqu’à aujourd’hui. L’histoire jouait une place importante, comme lieu de vérité, en nous confrontant aux défis réels acceptés et relevés par ces communautés de foi dans des environnements souvent hostiles. Leurs faiblesses, leurs convictions, leurs manières de s’organiser et de discerner, leurs manières d’accepter les défis sociétaux et de s’y impliquer, par leur foi en un Dieu incarné et vivant, étaient tellement vivifiantes !
Restauré, dans tous les sens du terme !
EFraTA, c’était aussi cette rencontre de pasteurs et de responsables d’Église avec leurs professeurs venant nourrir leur pratique. Une fois les cours terminés, on aimait passer du temps ensemble, parler de nos défis, demander parfois conseil ou simplement prier les uns aux côtés des autres. Même après nos études, cette formation continue que nous avions vécue ensemble agissait comme un repère et un souvenir commun. Nos chemins se croisent et se recroisent au fil de nos appels et des réponses que nous y apportons. Quel bonheur de revoir un tel dans le conseil d’administration d’une œuvre, un autre dans la préparation d’un culte commun ou dans un échange de chaire. Nous sommes devenus frères et sœurs en Christ !
Et puis, EFraTA, c’était aussi la période où nous avons accueilli notre premier enfant, où les nuits complètes se faisaient inexistantes. Alors, quel cadeau que deux nuits complètes et restauratrices pour reprendre des forces ! Quelle grâce de pouvoir me restaurer sur tous les plans, aussi bien spirituellement que dans mes appétits sensibles, intellectuels ou corporels ! Encouragé à chaque session, je pouvais aussi mieux accompagner notre famille et l’Église qui m’avait envoyé à mon retour.
Une formation actualisée et actuelle !
20 ans sont passés. Le monde est toujours, et peut-être même davantage, divisé et violent. Cet environnement fragmenté chahute les Églises, comme des barques prises dans la tempête, et, parfois, elles cèdent à la logique ambiante et deviennent elles-mêmes des lieux de violence et de casse. Heureusement, Dieu répare ! Et Dieu équipe. C’est fort de cette conviction que nous avons revu cette formation pour la proposer à nouveau à des pasteurs, à des responsables d’Églises, à des étudiants en théologie ou à toute personne intéressée à découvrir comment Dieu répare nos vies et son Église, et « rassemble tout dans le Christ » (Eph 1.10).
Ce nouvel EFraTA change de nom pour devenir « Spécialisation en théologie de la paix, Efrata 2.0 ». On voulait garder le meilleur de cette formation : l’Église, dans son lien au Christ, à la Parole, à une organisation et unité portée par l’Esprit et à la mission que Dieu lui confie. On voulait aussi amener du nouveau : une attention plus éthique (que faisons-nous lorsque nous disons « Dieu » ?) et pratique (quels outils et ressources pour vivre la paix du Christ dans nos Églises ?), tout en gardant un socle biblique, doctrinal et historique. Nous croyons que la paix de Dieu articule harmonieusement toutes ces dimensions et catégories. Notre perspective est clairement anabaptiste. Pas dans un sens identitaire où elle serait réservée aux Églises mennonites, mais dans un sens vocationnel, comme un appel à prendre au sérieux une théologie de la paix et à construire la paix dans l’Église, quelles que soient ses traditions et confessions.
Invitation :
Alors, venez, car tout est prêt ! Nous démarrons à l’automne 2026 avec une première année articulant la Bible à la vie de foi et à la vie d’Église.
Aller vers la page d’informations et le formulaire de préinscription
Paix et joie,
Alexandre