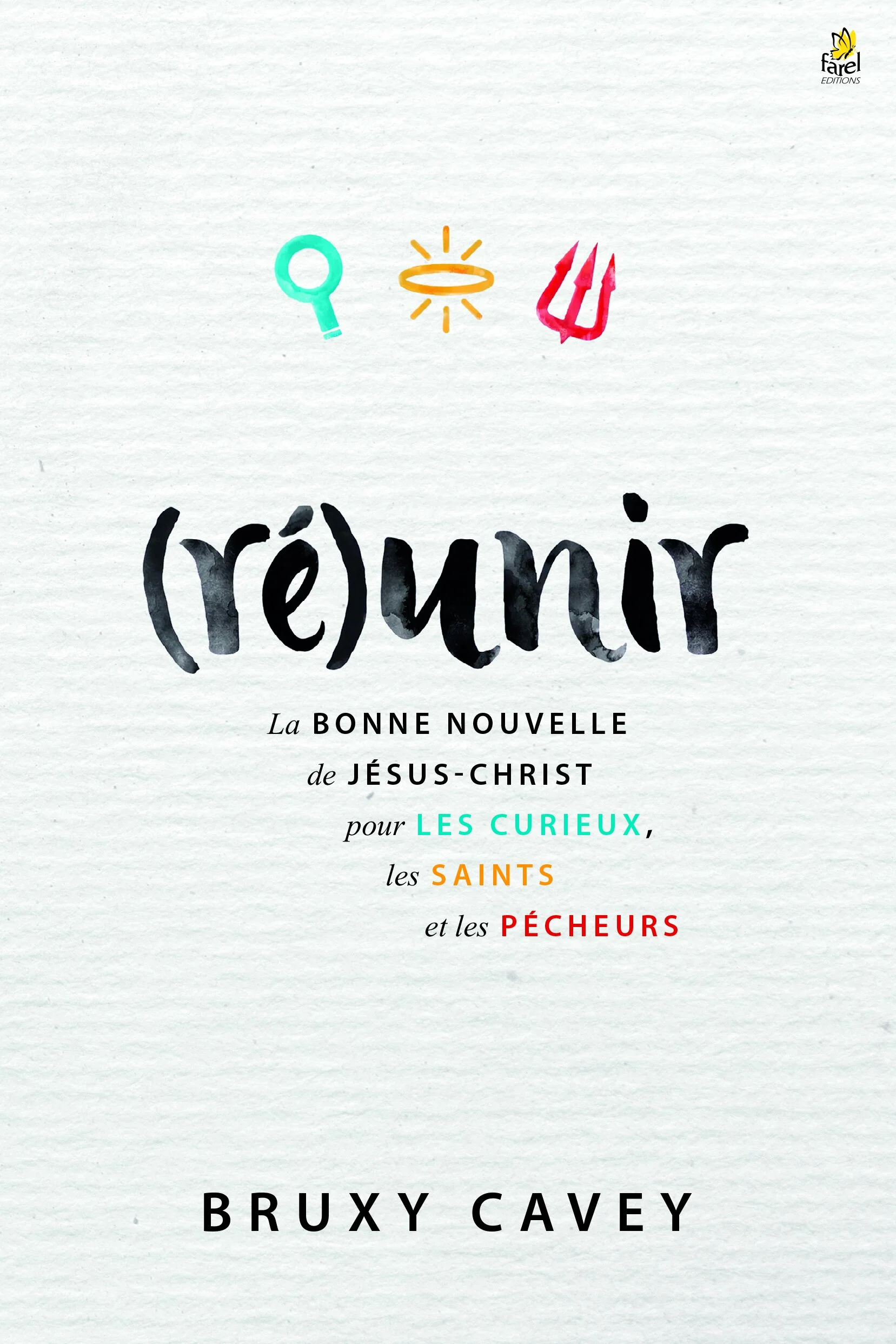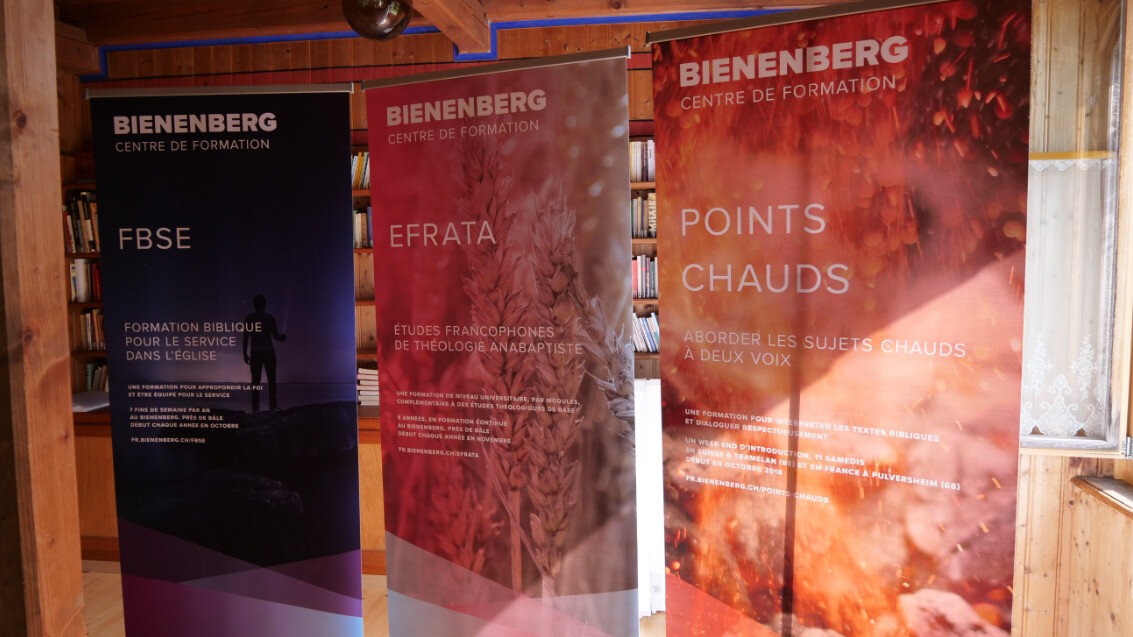Le retrait des troupes britanniques (et occidentales) d'Afghanistan en 2021, suivi de l’avancée des talibans et de la chute probable du pays vers un état de chaos, nous invite à réfléchir à la manière de clore les interventions militaires lorsque celles-ci n’atteignent pas les objectifs visés.
Vous avez dit défaite?
La réticence à reconnaître ces résultats comme des défaites peut se comprendre au vu des pertes humaines – en morts et en blessés –, du coût économique, et de l’embarras politique. Mais si les résultats escomptés ne sont pas atteints, il est important d'utiliser ce terme (défaite) et de réfléchir à ses implications. Ceux qui ont préconisé et autorisé cette intervention militaire devraient être tenus de rendre des comptes et invités à réfléchir aux décisions prises et aux résultats de ces décisions. La population, qui a financé ce conflit par les impôts, est en droit de questionner ce qui a été atteint et ce qui ne l’a pas été. Cette défaite donne l’occasion de discuter des priorités et stratégies futures. Des examens internes sont peut-être en cours et une commission d'enquête sera sans doute ouverte, mais le retrait des troupes s’est fait discrètement et avec peu de reconnaissance publique – en contraste avec la fin d'un conflit lorsqu’il est considéré comme victorieux. Les autorités préféreront donc peut-être éviter un examen approfondi.
Quel rôle les Églises ont-elles à jouer ?
Bien que les Églises n’aient pas été consultées dans la décision de déployer des troupes ou dans la définition des objectifs de l'intervention, l'Église d'État est traditionnellement invoquée pour marquer la fin des conflits, si leur issue semble satisfaisante. Dans le passé, cela se traduisait souvent par une forme de célébration de la victoire, généralement associée à un certain souci pour l'ennemi vaincu et quelques expressions d'un désir de paix. À titre d’exception, après le conflit des Malouines, lors duquel les forces britanniques avaient atteint l’objectif visé, le culte clôturant le conflit, contrairement aux souhaits de certains politiciens de haut rang, n'avait pas été pensé comme une célébration de la victoire, mais comme l'occasion d'une réflexion plus approfondie (un examen détaillé et des réflexions utiles sur ce culte sont disponibles (ici, en anglais uniquement). Marquer une défaite reste néanmoins une tout autre affaire.
Il y a bien sûr une question préalable à savoir si ce lien entre l'Église et la guerre est justifié à la lumière de l'enseignement de Jésus. La présence dans de nombreux édifices religieux d'insignes, d'inscriptions et d'accessoires militaires, la participation des responsables d’Église à des actes de commémoration, tels que les messes lors des jours de l’Armistice en France, et de nombreux autres liens sont issus de l’époque de la chrétienté, lorsque l'Église « avait fait la paix avec la guerre ».
Mais si les Églises sont impliquées dans les événements qui suivent un conflit, comment peuvent-elles réagir aux défaites ? Les politiciens et la population sont évidemment peu enclins à marquer ces occasions, préférant laisser l’Histoire les effacer discrètement. Mais cette démarche nous prive d’une réflexion sur ce qui eu a lieu, les raisons de l’échec, ce qui aurait pu être fait différemment et ce que l’on pourrait en retirer pour l'avenir. Cela empêche aussi les personnes touchées personnellement par le conflit de tourner la page. Les Églises pourraient-elles avoir un rôle plus proactif dans de telles situations ? Si oui, que pourraient-elles offrir ? Pourraient-elles proposer d'animer des échanges pour faciliter une réflexion sérieuse ?
Existe-t-il des ressources bibliques pertinentes à ce sujet?
Existe-t-il des ressources bibliques pertinentes à ce sujet ? Le peuple d'Israël a assurément subi de multiples défaites, certaines d'entre elles tout à fait inattendues. Le choc et la désorientation sont évidents dans certains passages. En voici deux exemples poignants :
Josué 7.4-9 : Ainsi, environ trois mille soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d’Aï qui leur tuèrent environ trente-six hommes : ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu’à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens.
Josué déchira ses vêtements, il se jeta, la face contre terre, devant le coffre de l’Eternel et resta là jusqu’au soir. Les responsables d’Israël firent de même. Et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s’écria : Ah ! Seigneur Eternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c’est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr ? Si seulement nous étions restés de l’autre côté du fleuve ! Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu’Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et les autres habitants du pays l’apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur ?
1 Samuel 4.10-22 : Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s’enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite : Israël perdit trente mille hommes. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d’Eli, Hophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin s’échappa du champ de bataille et courut jusqu’à Silo le jour même ; il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière en signe de deuil. Au moment où il arriva, Eli était assis sur son siège, aux aguets près de la route, car il était très inquiet au sujet du coffre de Dieu. L’homme vint annoncer la nouvelle dans la ville, et tous les habitants se mirent à pousser de grands cris. Quand Eli entendit ces cris, il demanda : Que signifie ce tumulte de la foule ?
L’homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Or Eli était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux éteints, il était complètement aveugle. L’homme dit à Eli : J’arrive du champ de bataille. Je m’en suis enfui aujourd’hui même. – Et que s’est-il passé, mon fils ? lui demanda Eli. Le messager lui répondit : Israël a pris la fuite devant les Philistins ; nous avons subi une terrible défaite ; même tes deux fils Hophni et Phinéas sont morts, et le coffre de Dieu a été pris.
Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Eli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte du sanctuaire, il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant quarante ans. Quand sa belle-fille, la femme de Phinéas qui arrivait au terme de sa grossesse, entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari étaient morts, elle chancela et, brusquement prise de contractions, elle accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l’entouraient lui dirent : Rassure-toi : c’est un garçon. Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l’enfant le nom d’I-Kabod (Plus de gloire), en expliquant : La gloire divine a quitté Israël. Elle pensait au coffre de Dieu qui avait été pris, à son beau-père et à son mari. Elle s’écria encore : Oui, la gloire a quitté Israël, car le coffre de Dieu a été pris.
La défaite la plus grave, avec les conséquences les plus lourdes, reste l'invasion d'Israël par les Assyriens et plus tard par les Babyloniens, entraînant la prise de Jérusalem et la déportation des Israélites en exil pendant plusieurs décennies. L'Ancien Testament contient de nombreuses expressions de lamentation, d’examen de conscience, de reconnaissance d'échec et d'inquiétude pour l'avenir. Ces passages offrent ainsi de riches ressources pour alimenter notre réflexion sur les défaites militaires, peu importe le contexte :
Le livre des Lamentations
Néhémie, chapitre 1
Daniel, chapitre 9
Psaume 137
Habacuc, chapitre 1
Ces exemples anciens, imprégnés de connotations et de compréhensions théologiques, sont évidemment bien différents des guerres séculières d'aujourd'hui, et aucune nation aujourd'hui ne peut prétendre avoir la faveur de Dieu à la manière du peuple d’Israël. On peut néanmoins déceler certains thèmes généraux : le chagrin face aux vies perdues, l’antipathie face à un ennemi victorieux, le questionnement sur les raisons de la défaite, la reconnaissance de ses erreurs, le souci de sa réputation, et la peur des conséquences de la défaite.
La doctrine de la guerre juste
La ressource traditionnellement utilisée pour évaluer la légitimité d’un conflit est la doctrine de la guerre juste. Il s’agit d’un ensemble exigeant de conditions permettant de déterminer à l'avance si une intervention militaire est justifiée ou non. Il existe plusieurs versions de ces critères, en voici en un résumé succinct:
La guerre doit être menée pour une cause juste, c’est-à-dire en légitime défense, pour la défense d'autrui, ou en réponse à un acte délibéré d'agression non provoquée.
La guerre doit être menée avec une bonne intention, telle que rectifier le mal et établir le bien, instaurer un ordre plus juste, rétablir la paix le plus tôt possible, et non par vengeance ou pour établir la suprématie sur les autres.
Il doit y avoir une probabilité raisonnable de succès, c’est-à-dire qu’il en résultera plus de bien que de mal.
La guerre doit être menée par des moyens appropriés, proportionnés et non excessifs, afin que les résultats de la victoire l'emportent sur les dommages causés pour y parvenir. Les civils ne doivent pas être blessés, aucun moyen intrinsèquement mauvais ne doit être utilisé, et les termes de la capitulation doivent être équitables et miséricordieux.
La guerre doit être l’unique moyen possible d'éliminer le mal : le dernier recours après avoir essayé toutes les autres réponses par la négociation ou les sanctions.
La guerre doit être déclarée et combattue par une autorité légitime, normalement l'État, bien que cela soit moins clair lors de guerres civiles.
Dérivés de sources classiques, adaptés pour être utilisés par l'Église et l'État au début de l'ère chrétienne et périodiquement affinés et mis à jour, ces critères ont exercé une influence importante dans la plupart des traditions ecclésiales pendant des siècles. Ces critères restent influents aujourd’hui malgré la préoccupation grandissante quant à leur applicabilité aux guerres modernes, et leur rejet par certaines traditions qui leur ont préféré le pacifisme. Bien qu’ils aient leurs limites, manquent de soutien biblique, et n’aient pas réussi à empêcher de nombreux conflits injustifiables à travers les siècles, ces critères – s'ils sont appliqués correctement – sont puissants et très restrictifs.
Les politiciens continuent d’utiliser le vocabulaire de la guerre juste pour justifier leurs décisions, bien que dénué de vocabulaire théologique et presque toujours sans référence aux critères spécifiques. Certains aspects de ces critères sont incorporés dans diverses déclarations internationales sur la conduite appropriée des conflits. Ces critères pourraient-ils donc être utilisés au lendemain d'un conflit, plutôt qu'avant, pour évaluer dans quelle mesure le conflit peut être considéré, rétrospectivement, comme justifiable ? Les Églises peuvent-elles initier ou jouer un rôle dans une telle discussion ?
L'un des critères de la guerre juste est une probabilité réaliste de succès quant à l’atteinte des objectifs de l’intervention militaire. Lors d’une défaite ou d’un résultat manqué, il semble justifié de réexaminer cette probabilité et de se demander si elle était, en effet, réaliste. Les autres critères fournissent des ressources supplémentaires pour ceux qui sont prêts à réfléchir honnêtement et sérieusement au conflit – ce qui l’a induit, comment il a été mené, quelles erreurs ont été commises, ce qui aurait pu être fait différemment, etc. S'appuyer ainsi sur ces critères pourrait encourager leur utilisation appropriée en amont de toute situation future de conflit.
Expériences et besoins
Au-delà de l’évaluation solide de la décision d'entrer en guerre, de la conduite de la guerre et de son issue décevante, on se doit de prêter attention aux expériences et aux besoins de ceux qui ont combattu, ont été blessés ou sont endeuillés. C'est le cas après tout conflit, mais lorsque le résultat n'a pas été satisfaisant, il peut y avoir une plus grande réticence à aborder ces problèmes, et d’autant plus besoin de le faire. La souffrance des blessés ou des endeuillés peut être exacerbée par la question de savoir si le sacrifice en valait la peine. L'honnêteté vis-à-vis des échecs doit être accompagnée de compassion et de façons d’honorer ceux dont la vie a été si profondément affectée par le conflit. Nous devons combattre la tendance dans l'Église et la société à célébrer les succès et à balayer les échecs sous le tapis – ceci par souci d'intégrité, afin de tirer les leçons nécessaires, et de répondre aux questions et besoins de ceux qui ressentent l’échec ou ne savent comment se sentir face à l’échec.
Une réflexion créative sur des approches et stratégies alternatives
La période post-conflit pourrait aussi être l'occasion d'une réflexion créative sur des approches et stratégies alternatives. Quelles autres possibilités auraient pu être explorées ? Si partir en guerre est un dernier recours (comme l'exigent les critères), y avait-il d'autres manières de procéder moins coûteuses et plus prometteuses qui n'avaient pas été envisagées ou pas suffisamment examinées ? Comment ces informations pourraient-elles éclairer les situations futures ?
L'utilisation des critères de la guerre juste pour examiner et évaluer ce qui s'est passé pourrait déplaire aux Églises attachées au pacifisme et à la non-violence. Mais bien que sceptiques quant à l’utilisation de ces critères avant de potentiels conflits, ces Églises pourraient reconnaître que ces critères sont en réalité très exigeants s'ils sont correctement appliqués, empêchant la guerre dans presque tous les contextes. L’utilisation rétrospective des critères lorsque l'action militaire n'est pas en jeu pourrait permettre leur bon usage et encourager ce bon usage à l'avenir. Bien que ces critères reposent sur des présupposés différents de ceux du pacifisme, s'ils sont utilisés correctement, l'écart entre ces deux approches n'est pas si grand. Les Églises engagées dans la non-violence pourraient soutenir ce processus, encourager l'application rigoureuse des critères et participer à la recherche d’alternatives pacifiques.
Auteur: Stuart Murray Williams. L’article complet est disponible en format téléchargeable ici. Article repris et traduit avec autorisation du site Amnetwork.
Traduction: Améline Nussbaumer.